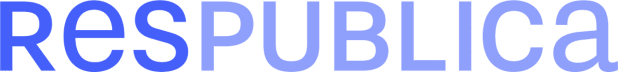Dominique de Villepin : le retour du diplomate et la tentation de l’Élysée en 2027…
Décryptage d'une ambition présidentielle
À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, la scène politique française pourrait bien voir le retour d’une figure aussi charismatique qu’atypique : Dominique de Villepin. L’ancien Premier ministre, célèbre pour son verbe haut et son indépendance d’esprit, multiplie les signaux laissant présager une candidature. Entre la publication de son nouvel ouvrage, « Le pouvoir de dire non », et une série d’initiatives publiques, Villepin semble vouloir s’imposer comme l’homme du sursaut républicain et du refus des conformismes. Décryptage d’une stratégie de retour, entre héritage gaullien, diplomatie flamboyante et critique acerbe du système politique actuel…
Un livre comme rampe de lancement
Le 25 juin 2025, Dominique de Villepin publiera chez Flammarion « Le pouvoir de dire non », un titre qui fait immédiatement écho à son intervention historique à l’ONU en 2003, lorsqu’il s’opposa, au nom de la France, à l’invasion de l’Irak par les États-Unis. Ce « non » solennel, devenu un symbole de l’indépendance diplomatique française, demeure la pierre angulaire de son identité politique.
Dans cet ouvrage, Villepin ne se contente pas de revisiter les grands moments de sa carrière. Il y expose une vision critique de la politique internationale actuelle, dénonce les dérives de la mondialisation et plaide pour une France forte, indépendante, capable de « dire non » aux injonctions extérieures, qu’elles viennent de Washington, de Bruxelles ou des marchés.
Un retour longuement mûri
Loin d’être un simple coup d’éclat éditorial, ce retour sur le devant de la scène s’inscrit dans une stratégie patiemment élaborée. Dominique de Villepin a multiplié ces derniers mois les rencontres discrètes avec des élus locaux, des intellectuels et des anciens collaborateurs. Il a également intensifié sa présence dans les médias, participant à des colloques et des débats, notamment sur les questions de souveraineté et de politique étrangère. Selon plusieurs proches, Dominique de Villepin aurait même constitué une petite équipe de fidèles, chargée de sonder le terrain et de préparer le lancement d’un mouvement citoyen. Ce cercle restreint, composé d’anciens diplomates, de gaullistes historiques et de jeunes cadres issus de la société civile, travaille à l’élaboration d’un programme et à la recherche de soutiens dans la France des territoires.
Un positionnement hors système
Dominique de Villepin n’a jamais caché son aversion pour les partis traditionnels. « Je ne crois pas à la politique des appareils, mais à la force des idées », répète-t-il à l’envi. Cette posture, qui lui a valu autant d’admirateurs que de détracteurs, le place aujourd’hui en marge d’un paysage politique en pleine recomposition. Son discours, nourri de références gaulliennes et d’une vision exigeante de la République, tranche pour certains observateurs avec le pragmatisme gestionnaire d’Emmanuel Macron et le populisme des extrêmes. Pour Dominique de Villepin, la France doit retrouver le sens du tragique et de la grandeur, renouer avec une politique étrangère indépendante et défendre son modèle social contre les assauts du néolibéralisme. Il se présente ainsi comme l’héritier d’une tradition républicaine exigeante, capable de rassembler au-delà des clivages partisans.
Un contexte politique favorable ?
La fragmentation du paysage politique français, l’usure des partis traditionnels et la montée des extrêmes créent un contexte inédit. Les dernières élections européennes ont confirmé la défiance d’une grande partie de l’électorat envers les formations classiques, tandis que la droite républicaine peine à se renouveler et que la gauche demeure divisée. Dans ce climat de défiance, Dominique de Villepin espère incarner une alternative crédible, susceptible de séduire les électeurs modérés, les gaullistes orphelins, mais aussi une partie de la jeunesse en quête de sens et d’engagement. Il mise sur sa stature internationale et son expérience pour apparaître comme le recours d’une France déboussolée.
Les obstacles d’une candidature
Mais la route vers l’Élysée est semée d’embûches. Dominique de Villepin n’a jamais été élu au suffrage universel, ce qui alimente le procès en « candidat hors-sol ». Son absence d’ancrage local et de réseau militant solide pourrait lui coûter cher dans une campagne où la mobilisation de terrain reste décisive. De plus, son image d’aristocrate républicain, cultivée mais distante, peut apparaître décalée dans une société en quête de proximité et d’authenticité… Sa tentative présidentielle de 2012 s’était soldée par un échec, faute de signatures et de dynamique populaire. Mais ses partisans rétorquent que le contexte a changé, et que l’usure du macronisme, la crise des partis, et la nostalgie d’une France souveraine pourraient jouer en sa faveur.
Une stratégie de rassemblement
Conscient de ses faiblesses, Dominique de Villepin mise sur une stratégie de rassemblement. Il multiplie les appels à l’unité des républicains, tend la main aux centristes déçus et aux gaullistes historiques, et cherche à fédérer autour de lui une « France des idées » plutôt qu’une « France des partis ». Il n’exclut pas de s’appuyer sur des mouvements citoyens, voire de s’allier avec des personnalités issues de la société civile, pour donner corps à sa candidature. Dominique de Villepin travaillerait également à l’élaboration d’un programme ambitieux sur les questions européennes, la transition écologique et la refondation de l’école, conscient que le seul registre de la politique étrangère ne suffira pas à convaincre les électeurs.
Le pari du « troisième homme »
Dans un paysage politique éclaté, Dominique de Villepin pourrait jouer le rôle du « troisième homme », capable de déjouer les pronostics et de s’imposer comme l’alternative à la fracture de la politique française en trois grands blocs. Selon un récent sondage Ifop-Fiducial réalisé pour Paris Match et Sud Radio, Dominique de Villepin reprend la première place du palmarès des personnalités politiques les plus appréciées des Français au mois de mai, devançant Édouard Philippe. L'ex-Premier ministre recueille 51 % d'opinions favorables, gagnant un point comparé à avril, mois durant lequel il avait cédé de justesse la première position à Édouard Philippe, l'ancien chef du gouvernement sous Emmanuel Macron. Dominique de Villepin avait déjà occupé le sommet de ce classement en février et mars. Dans son camp, plusieurs sondages internes, cités par ses proches, le créditent d’un potentiel intéressant des intentions de vote dans l’électorat, un socle suffisant pour peser dans la campagne et, peut-être, créer la surprise. « Je crois au pouvoir de dire non, mais surtout au pouvoir de proposer une autre voie pour la France », a-t-il confié à ses proches.
Un pari risqué, mais porteur d’espoir
Dominique de Villepin, l’homme du « non » à la guerre en Irak, veut aujourd’hui dire « oui » à la France. Son retour, à la faveur d’un livre essai et d’une stratégie de rassemblement, pourrait bien rebattre les cartes d’une présidentielle plus ouverte que jamais. Reste à savoir si les Français, lassés des promesses non tenues et des querelles partisanes, seront prêts à accorder leur confiance à ce diplomate-poète, héritier d’une certaine idée de la France.
Bio de Dominique de Villepin : Ancien Premier ministre de Jacques Chirac (2005-2007)
Né le 14 novembre 1953 à Rabat au Maroc, Dominique Galouzeau de Villepin, davantage reconnu sous l'appellation de Dominique de Villepin, effectue de nombreux déplacements durant sa jeunesse, particulièrement sur les territoires africain et sud-américain. Son père, Xavier de Villepin, exerce alors les fonctions de sénateur représentant les Français résidant à l'étranger tandis que sa mère, Yvonne Hétier, détient le rang de première conseillère au sein d'un tribunal administratif.
Titulaire d'un diplôme de l'ENA, où il fréquente notamment François Hollande et Ségolène Royal, Dominique de Villepin se lance dans l'arène politique et rallie le RPR en 1977. Sa trajectoire professionnelle amorcée, il convoite la fonction de diplomate, puis celle de premier secrétaire à l'ambassade française aux États-Unis, ou encore premier conseiller à l'ambassade de France en Inde. Allié de Jacques Chirac, il est désigné secrétaire général de la présidence de la République lorsque celui-ci accède au pouvoir en 1995.
Il accède au portefeuille des Affaires étrangères en 2002 et marque les consciences en délivrant son allocution à l'ONU s'opposant à l'engagement militaire français en Irak. Son parcours politique acquiert alors une ampleur inédite. Entre 2004 et 2005, il assume les responsabilités de ministre de l'Intérieur, puis endosse le rôle de Premier ministre à compter du 31 mai 2005 jusqu'au scrutin présidentiel de 2007 qui consacre la victoire de son adversaire, Nicolas Sarkozy. Douze mois plus tard, les complications judiciaires débutent. Il se trouve impliqué dans l'affaire Clearstream qui l'oppose à Nicolas Sarkozy. Il obtient un acquittement en première comme en seconde instance en 2011. Il fait alors le choix de briguer la magistrature suprême lors du scrutin présidentiel de 2012, mais doit y renoncer, n'ayant pas réuni les 500 parrainages requis.
Comment son parcours diplomatique influence-t-il ses idées pour la France de demain
Dominique de Villepin, figure marquante de la diplomatie française et ancien Premier ministre, façonne depuis plus de vingt ans une vision politique profondément imprégnée par son expérience internationale. Son parcours, jalonné de crises majeures et d’engagements forts, continue d’inspirer ses propositions pour l’avenir de la France, notamment à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.
Indépendance et multilatéralisme : l’héritage du « non » à la guerre en Irak
Le moment fondateur de la carrière diplomatique de Dominique de Villepin reste incontestablement son discours à l’ONU en 2003, où il s’oppose à l’intervention américaine en Irak. Ce refus, salué comme un symbole d’indépendance, incarne sa conviction qu’une grande nation doit savoir dire « non » face aux pressions extérieures et défendre une diplomatie autonome et équilibrée. Cette posture gaullienne irrigue encore aujourd’hui ses idées pour la France, qu’il veut souveraine, capable de peser sur la scène internationale sans s’aligner systématiquement sur les grandes puissances.
Le multilatéralisme comme boussole
Dominique de Villepin défend une France actrice du multilatéralisme, persuadé que les grands défis – guerres, terrorisme, migrations, climat – ne peuvent être résolus que par la coopération internationale. Face à la montée de l’unilatéralisme, il plaide pour la création de nouvelles enceintes de dialogue, notamment avec les pays du Sud global et la Chine, afin de rééquilibrer les rapports de force mondiaux. Selon lui, la France doit jouer un rôle de médiateur et d’architecte de la paix, fidèle à sa tradition diplomatique, en particulier dans les crises comme la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, où il défend la reconnaissance de l’État palestinien et la recherche de solutions négociées.
Un État stratège face aux défis du XXIe siècle
Son expérience de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre l’a convaincu de la nécessité d’un État stratège, capable d’anticiper les crises plutôt que de les subir. Dominique de Villepin critique la gestion à courte vue et prône un retour à une vision de long terme, où l’État fixe un cap et structure l’action publique, à la manière des grands moments gaulliens. Il s’oppose à la simple gestion technocratique et appelle à une refondation du pacte républicain, menacé selon lui par la montée des extrêmes et la perte de repères collectifs.
Dialogue, humanisme et refus de la brutalité
Marqué par les échecs et les limites de l’interventionnisme militaire, Dominique de Villepin privilégie toujours le dialogue à la confrontation. Il met en garde contre les politiques de surenchère sécuritaire et identitaire, qu’il juge contre-productives et dangereuses pour la cohésion nationale. Son expérience l’a amené à considérer que la sécurité ne peut être dissociée des questions diplomatiques, économiques et mémorielles. Il prône un humanisme républicain, fidèle à la tradition française de médiation et de respect du droit international.
Ouverture au monde et souveraineté nationale
Si Dominique de Villepin revendique une souveraineté française renforcée, il n’en demeure pas moins un ardent défenseur de l’ouverture au monde. Pour lui, la France doit rester fidèle à son histoire d’accueil, de dialogue et de rayonnement culturel, tout en sachant protéger ses intérêts et son identité dans un contexte de mondialisation chaotique. Ce nationalisme pragmatique, allié à une volonté d’influence internationale, structure sa vision d’une France à la fois forte, indépendante et ouverte.
Dominique de Villepin tire de son parcours diplomatique une vision singulière pour la France de demain : une nation indépendante, stratège, humaniste et multilatérale, capable de dire « non » mais aussi de proposer, de dialoguer et de rassembler. À l’heure où la tentation du repli et de la polarisation menace le pacte républicain, il propose de renouer avec l’esprit du gaullisme et de la grande diplomatie française, pour redonner à la France un rôle moteur dans un monde en pleine recomposition…