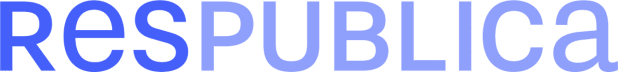Emmanuel Macron pourrait-il de nouveau dissoudre l’Assemblée nationale ?
Un an après le choc politique de la dissolution de l’Assemblée nationale, la question d’une nouvelle utilisation de ce levier par Emmanuel Macron alimente les débats et les spéculations à Paris. Si le président de la République n’exclut pas totalement ce recours, la Constitution et la situation politique actuelle encadrent strictement cette éventualité. Selon un sondage Elabe diffusé le 7 juin, 71 % des Français jugent aujourd'hui la décision de juin 2024 comme une erreur. De plus, 63 % des personnes interrogées considèrent que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nuit au pays en créant des blocages et en ralentissant la prise de décision…
Un pouvoir constitutionnel, mais sous conditions
L’article 12 de la Constitution de la Ve République accorde au président le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale, après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres. Cependant, ce pouvoir n’est pas illimité : il ne peut y avoir de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections législatives consécutives à une précédente dissolution. Or, les dernières élections législatives ont eu lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Par conséquent, Emmanuel Macron doit attendre au moins le 8 juillet 2025 pour pouvoir, s’il le souhaite, dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale.
Cette règle vise à éviter les crises institutionnelles à répétition et à garantir une certaine stabilité parlementaire. Elle trouve son origine dans l’expérience historique des dissolutions successives du XIXe siècle, qui avaient plongé la France dans l’instabilité…
Le président laisse planer le doute
Interrogé à plusieurs reprises sur ses intentions, Emmanuel Macron a affirmé que son « souhait est qu’il n’y ait pas d’autre dissolution » d’ici la fin de son mandat en 2027, tout en se gardant de fermer définitivement la porte à cette option. Il a justifié cette prudence en soulignant que « … Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel, parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et de bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation où je dois utiliser la Constitution ».
Cette déclaration entretient une forme d’ambiguïté, perçue par certains comme une stratégie pour maintenir la pression sur les partis politiques et les inciter à coopérer au sein d’une Assemblée fragmentée.
Un contexte politique incertain
Depuis la dissolution de 2024, le paysage politique français reste marqué par la confusion et l’absence de majorité claire. La recomposition des alliances et la montée des extrêmes compliquent la tâche du gouvernement, qui doit composer avec une Assemblée nationale plus morcelée que jamais. Dans ce contexte, la menace d’une nouvelle dissolution agit comme une épée de Damoclès, susceptible de dissuader les blocages les plus radicaux.
Néanmoins, le président Emmanuel Macron a reconnu que la dissolution de 2024 n’avait pas été « comprise » par les Français, tout en rejetant les critiques d’immobilisme adressées à l’exécutif. Il renvoie notamment la responsabilité aux partis politiques, appelés à « travailler ensemble pour bâtir de l’action ».
Des obstacles juridiques et politiques
Si, juridiquement, une nouvelle dissolution est possible à partir du 8 juillet 2025, elle reste politiquement risquée. D’une part selon les observateurs politiques, elle pourrait être perçue comme un aveu d’échec à gouverner et aggraver la défiance envers les institutions. D’autre part, rien ne garantit qu’un nouveau scrutin législatif offrirait une majorité plus stable au président.
Enfin, la Constitution interdit la dissolution dans certains cas particuliers : si l’année n’est pas écoulée depuis les dernières élections, en cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels du président (article 16), ou en cas d’intérim présidentiel.
Emmanuel Macron pourra, en théorie, dissoudre l’Assemblée nationale à partir de l’été 2025. Mais ce pouvoir, s’il demeure un outil constitutionnel à sa disposition, est encadré par des délais stricts et des risques politiques majeurs. Pour l’heure, le chef de l’État Emmanuel Macron préfère laisser planer le doute, tout en espérant que les forces politiques assument leurs responsabilités et parviennent à faire fonctionner l’Assemblée nationale sans recourir à une nouvelle dissolution… A moins que peut-être le président n’appuie à nouveau cet été sur le bouton nucléaire…
La dissolution parlementaire sous la Ve République : un instrument stratégique face aux turbulences politiques
Depuis l'avènement de la Ve République en 1958, la dissolution de l'Assemblée nationale demeure un recours exceptionnel, mobilisé principalement lors de périodes de tensions institutionnelles majeures.
De Gaulle : deux dissolutions victorieuses
Le fondateur de la Ve République a eu recours à cette prérogative présidentielle à deux occasions, remportant à chaque fois son pari politique. En 1962, puis en 1968, Charles de Gaulle estimait faire face à des crises institutionnelles d'envergure nécessitant l'arbitrage direct des citoyens.
L'épisode de 1962 intervient dans un contexte particulièrement tendu : l'exécutif dirigé par Georges Pompidou venait d'essuyer une motion de censure parlementaire - événement unique dans l'histoire de la Ve République. Cette sanction législative sanctionnait la volonté du chef de l'État d'organiser un référendum visant à modifier la Constitution pour instaurer l'élection présidentielle au scrutin universel direct.
Six années plus tard, en juin 1968, la France pansait encore ses plaies après les bouleversements de la crise étudiante puis du mouvement ouvrier de mai 1968. La population conservatrice, particulièrement en province, restait marquée par les débordements constatés et les compromis accordés aux organisations syndicales. De Gaulle jugea nécessaire de redéfinir l'équilibre des forces politiques au sein de l'hémicycle face aux manifestations de rue. Ce calcul s'avéra payant : les forces gaullistes obtinrent un résultat bien supérieur aux législatives précédentes (293 élus contre 200 en 1967 sur un total de 487 sièges).
Mitterrand : la recherche de majorités présidentielles
François Mitterrand opta pour cette stratégie constitutionnelle en 1981 et 1988, sollicitant à chaque fois le corps électoral afin d'obtenir une assemblée compatible avec son programme présidentiel fraîchement plébiscité. Dans les deux cas, cette démarche porta ses fruits.
L'échec de Chirac : quand la tactique tourne court
Seul Jacques Chirac osa franchir le pas en 1997 sans justification de crise politique apparente. Cette manœuvre, purement tactique, se solda par un revers : la formation présidentielle, qui disposait pourtant d'une majorité avant la dissolution, la perdit lors du scrutin législatif. Cette défaite inattendue ouvrit la voie à la troisième cohabitation de la Ve République, plaçant Lionel Jospin à la tête du gouvernement.
Première dissolution pour Emmanuel Macron
Après l'échec de son parti lors des élections européennes du 9 juin 2024, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale le soir même…
L'échiquier politique face à l'éventualité d'une nouvelle dissolution d’Emmanuel Macron
La perspective d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale à partir du 8 juillet 2025 ouvre plusieurs scénarios politiques, chacun porteur de transformations majeures pour l'équilibre institutionnel français. Dans un contexte de fragmentation parlementaire inédite, les hypothèses sont nombreuses à se dessiner… Dans ce paysage complexe, une certitude s'impose : l'arme constitutionnelle de la dissolution n'est plus un outil de résolution des crises, mais un facteur d'incertitude supplémentaire dans une démocratie en recomposition. L'issue dépendra moins des prérogatives présidentielles que de la capacité des forces politiques à réinventer leur rapport au pouvoir ou à sombrer dans l'immobilisme…