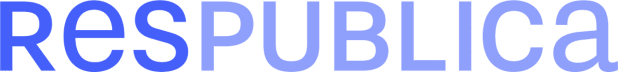La menace de la Chine contre Taïwan pourrait-elle être imminente ?
L'escalade des tensions pourrait-elle déboucher sur un affrontement armé ? Cette préoccupation est partagée par Pete Hegseth, secrétaire d'État américain à la Défense, qui a averti le 31 mai 2025 que la menace chinoise contre Taïwan est tangible et potentiellement imminente. Il a exhorté les alliés américains à accroître leurs budgets militaires dans le but de prévenir un conflit. Pékin réplique avec fermeté en sommant Washington de « ne pas jouer avec le feu »… L'inquiétude grandit face à la multiplication des manœuvres militaires chinoises ces derniers mois, Washington soulignant que l'objectif de Xi Jinping de préparer son armée à une invasion de Taïwan avant 2027 est désormais réel. L'Armée populaire de libération (APL), bras armé du Parti communiste chinois, développe quotidiennement ses capacités opérationnelles et répète inlassablement ses exercices d'invasion. La tension entre la Chine et Taïwan atteint aujourd’hui un niveau critique, alimentant les craintes d’un conflit armé dans un avenir proche. Pour comprendre cette escalade, il faut revenir sur l’histoire du différend, les développements récents, et les dynamiques internes et internationales qui façonnent la situation actuelle…
Origines du conflit : une histoire de séparation et de rivalité
Suite à la reddition du Japon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile chinoise entre nationalistes et communistes bascule rapidement en faveur de ces derniers. Le 8 décembre 1949, le dirigeant nationaliste Tchang Kaï-chek s'exile sur l'île de Formose (Taïwan) où il installe son gouvernement. Après la guerre civile chinoise (1927-1949), le parti nationaliste Kuomintang (KMT), défait par les communistes de Mao Zedong, se réfugie donc à Taïwan en 1949 avec environ deux millions de personnes. Cet exode est parfois désigné sous le nom de « Grande Retraite » par le gouvernement taïwanais. Le Kuomintang, ses cadres et approximativement deux millions de militaires chinois ont participé à ce repli, accompagnés de nombreux civils et réfugiés.
La démocratisation s'amorce dans les années 1970 et s'approfondit progressivement tandis que Taïwan intègre le cercle des « pays développés ». Au cours des années 1990, le multipartisme est instauré et un système électoral mis en œuvre. Le débat politique se cristallise autour de la question indépendantiste. Taïwan connaît aussi un essor économique spectaculaire de 1970 à 1990 et s'impose comme le premier des « quatre dragons » asiatiques, devançant la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour.
Taïwan fonctionne comme un État de facto indépendant, avec son propre gouvernement, sa monnaie et son armée, mais n’a jamais proclamé formellement l’indépendance. Pékin considère toujours l’île comme une province chinoise à réunifier, par la force si nécessaire.
Accélération des tensions depuis 2016
L’élection de Tsai Ing-wen (Parti démocrate progressiste, PDP) à la présidence de Taïwan en 2016 marque un tournant. Elle est élue présidente de la République le 11 janvier 2016. Tsai Ing-wen refuse de reconnaître le « consensus de 1992 » sur l’existence d’une seule Chine, ce qui irrite fortement Pékin. Depuis, la Chine intensifie sa pression militaire, diplomatique et économique sur l’île, multipliant les incursions d’avions de chasse dans la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise et organisant de vastes exercices militaires autour de l’île de Taïwan.
En mai 2024, Lai Ching-te, également du Parti démocrate progressiste, maire de Tainan de 2010 à 2017, Premier ministre de la république du 8 septembre 2017 au 14 janvier 2019, succède à Tsai Ing-wen (qui a effectué deux mandats à la présidence de Taïwan). Considéré comme plus indépendantiste, Lai Ching-te est immédiatement la cible de critiques virulentes de Pékin, qui le qualifie de « séparatiste » et multiplie les démonstrations de force… Après avoir quitté ses fonctions présidentielles en mai 2024, l’ex-présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a mis à profit sa nouvelle liberté pour servir la diplomatie parallèle de Taïwan. En octobre 2024, elle s'est rendue à Prague, Paris et Bruxelles, provoquant l'irritation de Pékin.
Plusieurs nouvelles menaces et provocations ont marqué récemment la relation sino-taïwanaise, accentuant la tension déjà très élevée dans le détroit de Taïwan…
Quelles nouvelles menaces ou provocations ont marqué la relation sino-taïwanaise récemment ?
Multiplication des incursions militaires chinoises
En 2025, Taïwan a détecté des centaines d’avions et plusieurs navires de guerre chinois autour de son territoire en l’espace de quelques jours. Par exemple, le 18 septembre 2025, 103 avions et neuf navires chinois ont été repérés en 24 heures près de l’île, un record qui témoigne de l’intensification des opérations militaires chinoises visant à intimider Taïwan. Ces incursions sont souvent présentées par Pékin comme des exercices, mais Taïpei les considère comme des provocations directes.
Manœuvres militaires de grande ampleur
Le 23 mai 2024, juste après l’investiture du président taïwanais Lai Ching-te, la Chine a lancé des exercices militaires d’envergure autour de Taïwan, qualifiés par Pékin de « punition sévère » envers le nouveau dirigeant. Ces manœuvres impliquent des frappes simulées, des blocus et des débarquements amphibies, visant à montrer la capacité de la Chine à isoler et attaquer l’île.
Discours et attaques verbales
Lai Ching-te, élu en janvier 2024, est devenu la « bête noire » de Pékin. Son discours affirmant que Taïwan est déjà un pays indépendant a été qualifié comme un « aveu d’indépendance » par la Chine, qui a intensifié ses attaques verbales, allant jusqu’à traiter le président taïwanais de « parasite ». Ces déclarations enveniment le climat politique et justifient aux yeux de Pékin une montée en pression.
Réactions internationales et tensions diplomatiques
Les États-Unis ont dénoncé ces opérations chinoises comme des provocations « injustifiées » et avec un « risque d’escalade ». Le ministre américain de la Défense a affirmé que la Chine se prépare « à potentiellement utiliser la force militaire » en Asie-Pacifique, région qu’il qualifie de « théâtre prioritaire ». Par ailleurs, la visite de responsables étrangers à Taïwan, comme celle en août 2022 de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a toujours provoqué des réactions militaires et diplomatiques très vives de Pékin.
Activités navales et incidents récents
En juin 2025, la Chine a déployé près de 90 navires de guerre autour de Taïwan, le plus important déploiement depuis 2022, en réaction à la tournée du président taïwanais dans le Pacifique. Par ailleurs, des incursions de porte-avions chinois au sud de l’île ont été détectées, provoquant un état d’alerte à Taïpei.
Cybermenaces et sabotage
Taïwan a également signalé des tentatives de sabotage, comme la rupture suspecte d’un câble sous-marin reliant les îles Pescadores (situées à l'ouest des côtes taïwanaises) à l’île principale, attribuée à un capitaine de navire chinois dont le cargo battant pavillon togolais, le Hongtai, avait jeté l’ancre dans une zone maritime située au sud-ouest de l’île. Ce type d’action illustre la dimension hybride des provocations chinoises, combinant militaire, cyber et sabotage.
Les récentes provocations chinoises se traduisent par :
- Une intensification spectaculaire des incursions aériennes et navales autour de Taïwan
- Des exercices militaires massifs et des simulations d’invasion
- Une rhétorique agressive ciblant le président taïwanais Lai Ching-te
- Des tensions diplomatiques exacerbées, notamment avec les États-Unis et leurs alliés
- Des actes de sabotage et des cyberattaques visant à déstabiliser l’île
Ces éléments confirment une volonté chinoise claire de faire pression sur Taïwan et de préparer le terrain à une éventuelle action militaire, tout en testant la résilience politique et militaire de l’île ainsi que la réaction de la communauté internationale
2025 : une année charnière
En 2025, la situation s’est encore tendue. L’armée chinoise organise régulièrement des exercices simulant des débarquements et des blocus de Taïwan.
Les États-Unis, principaux soutiens de Taïwan, tirent la sonnette d’alarme avec la possibilité d’une invasion chinoise d’ici 2027, voire plus tôt. Les États-Unis estiment que la Chine pourrait donc tenter une action militaire contre l’île de Taïwan d’ici deux ans, mais certains experts et analystes avancent même la date de 2025.
Les scénarios d’attaque et la préparation chinoise
La Chine pourrait recourir à plusieurs stratégies :
- Blocus maritime et aérien pour isoler l’île et tester la réaction internationale
- Cyberattaques et campagnes de désinformation pour désorganiser la société taïwanaise
- Invasion amphibie, la plus risquée, nécessitant une supériorité militaire et une logistique massive
L’armée chinoise s’entraîne à toutes ces options, comme l’ont montré les exercices d’envergure en mai 2025, impliquant des débarquements simulés, des frappes de missiles et des opérations de blocus.
Réactions de Taïwan et de la population
Face à la menace, Taïwan renforce son service militaire (passé de 4 à 12 mois en 2024), multiplie les exercices de défense civile et modernise ses équipements militaires. La société reste partagée : une partie de la population croit à la possibilité d’une invasion, l’autre mise sur la dissuasion américaine et la résilience de l’île.
Le rôle crucial des États-Unis et des alliés
Les États-Unis, sans reconnaître officiellement Taïwan, fournissent une aide militaire et s’engagent à soutenir l’île selon le Taiwan Relations Act de 1979. Un désengagement américain, évoqué à plusieurs reprises, pourrait inciter Pékin à agir. À l’inverse, une intervention directe risquerait de transformer le conflit en guerre régionale, voire mondiale.
Enjeux économiques et technologiques
Taïwan est le leader mondial de la production de semi-conducteurs, notamment via la TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Elle est, en 2021, la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante. Une attaque chinoise provoquerait une crise majeure dans la tech mondiale, affectant l’économie planétaire.
Pourquoi la situation est explosive en 2025 ?
- Pékin resserre l’étau : manœuvres militaires, pressions économiques, diplomatiques et campagnes de désinformation
- Taïwan résiste : renforcement militaire, alliances, mobilisation de la société civile
- La rhétorique s’envenime : Pékin dénonce régulièrement les « provocations » de Taipei, notamment après les discours de Lai Ching-te en mai et juin 2025
- Les États-Unis restent ambigus : soutien militaire, mais incertitudes sur l’ampleur d’une intervention directe
La situation actuelle résulte d’une longue histoire de rivalité, d’un durcissement des positions depuis 2016, et d’une accélération des préparatifs militaires depuis 2024. Les prochaines années, notamment jusqu’en 2027, sont considérées comme les plus dangereuses pour un possible conflit, avec des conséquences potentiellement majeures pour la stabilité régionale et l’économie mondiale.
Depuis 2020, la montée des tensions entre Pékin et Taipei s’est accélérée de manière spectaculaire, marquant une nouvelle phase de confrontation militaire, diplomatique et politique autour du statut de Taïwan.
2020-2022 : Intensification de la coercition militaire
Depuis 2020, la Chine a adopté une posture beaucoup plus agressive envers Taïwan, multipliant les démonstrations de force et les incursions militaires autour de l’île. Le nombre d’incursions de navires chinois dans la zone économique exclusive taïwanaise est passé de 71 en 2018 à 600 en 2019, puis à 3487 en 2020. En 2022, plus de 2000 intrusions aériennes chinoises ont été recensées dans la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise.
Août 2022 : La visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine, à Taïwan provoque une réaction immédiate de Pékin, qui lance ses plus grands exercices militaires autour de l’île depuis des décennies, marquant ce que certains appellent la « quatrième crise du détroit de Taïwan »
2023-2024 : Escalade politique et manœuvres militaires
Janvier 2024 : Élection de Lai Ching-te à la présidence taïwanaise, membre du Parti démocrate progressiste (PDP), perçu par Pékin comme ouvertement indépendantiste
Mai 2024 : Investiture de Lai Ching-te le 20 mai. Son discours, dans lequel il qualifie la Chine de « force étrangère hostile » et affirme que Taïwan est déjà un pays indépendant. Il est immédiatement dénoncé par Pékin comme un « aveu d’indépendance »
23 mai 2024 : En réponse à l’investiture de Lai Ching-te, la Chine lance des exercices militaires massifs autour de Taïwan, présentés comme une « punition sévère » contre les « forces indépendantistes ». Ces manœuvres impliquent toutes les branches de l’armée chinoise et simulent des frappes sur des infrastructures stratégiques et des scénarios de blocus
Juin 2025 : Un responsable de la sécurité taïwanaise a rapporté que la Chine avait positionné deux formations de porte-avions ainsi que des dizaines d'unités navales dans les zones maritimes encadrant Taïwan au cours du mois de juin 2025, témoignant de la poursuite des tensions militaires entre Pékin et l'île de Taïwan qu'elle revendique
2025 : Vers une militarisation totale du détroit
Avril 2025 : Lancement de l’exercice « Strait Thunder-2025A » par la Chine, mobilisant forces terrestres, navales, aériennes et de missiles. Ces opérations visent à tester la capacité d’encerclement de l’île, à simuler des frappes de précision et à renforcer la maîtrise du théâtre d’opérations autour de Taïwan. Les exercices incluent des simulations de blocus maritime, d’interception de cibles mobiles et de neutralisation de nœuds logistiques, ciblant notamment les îles périphériques taïwanaises comme Kinmen et Matsu.
Le ministère taïwanais de la Défense a qualifié ces manœuvres de provocations majeures et affirme que l’île dispose des moyens nécessaires pour se défendre.
Facteurs aggravants
Rôle des États-Unis : Washington a réaffirmé ces dernières années son engagement à la dissuasion dans le détroit de Taïwan, mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 introduit une incertitude sur la nature du soutien américain à l’île. Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison-Blanche le 12 mai 2025, le président américain a déclaré que les négociations avec la Chine seraient « fantastiques pour l'unification et la paix ». Cette déclaration a suscité des préoccupations à Taïwan, où l'on redoute un rattachement forcé à la République populaire de Chine.
Comment Taïwan renforce-t-il sa défense face aux incursions chinoises ?
Taïwan renforce sa défense face aux incursions chinoises par une stratégie combinant modernisation militaire, développement de la guerre asymétrique et mobilisation de la population civile.
Inspirée par la guerre en Ukraine, Taïwan investit aussi dans les drones militaires et envisage depuis janvier 2025 la création d’une « Légion étrangère » sur le modèle français ou américain, en intégrant des soldats étrangers pour pallier la baisse du recrutement dans l’armée. Face à l'escalade des menaces militaires chinoises, Taïwan se trouve confronté à un paradoxe : alors que le besoin de renforcer ses effectifs militaires devient urgent, l'armée nationale éprouve de grandes difficultés à recruter de nouveaux soldats.
Taïwan dispose d’environ 150 000 soldats, une flotte navale composée d’une trentaine de navires (frégates, destroyers) et environ 400 avions de chasse, dont une partie est constituée de Mirage 2000 français acquis dans les années 1990. Face à la montée en puissance rapide de l’Armée populaire de libération chinoise, Taïwan investit dans la modernisation de ses équipements, notamment avec l’achat de chasseurs américains F-16 Viper de dernière génération et de systèmes antichars et antiaériens portables (Javelin, Stinger). Ces armes légères sont privilégiées pour leur efficacité dans une guerre asymétrique, inspirée par l’exemple ukrainien, afin d’infliger des pertes importantes à moindre coût.
Consciente qu’elle ne peut rivaliser avec la supériorité numérique et technologique chinoise, Taïwan mise sur une défense asymétrique, rendant toute invasion trop coûteuse pour Pékin. Cela inclut le déploiement de drones, de missiles mobiles, et la multiplication des systèmes de défense répartis sur l’ensemble du territoire. La stratégie vise à décourager l’agresseur par une résistance tenace et diffuse, plutôt que par une confrontation frontale classique.
Depuis juillet 2024, sous l’impulsion du président Lai Ching-te, Taïwan a lancé le Comité pour la résilience de la défense de la société entière, visant à mieux préparer la population civile face à une éventuelle invasion. Bien que la formation militaire citoyenne reste encore marginale, des propositions existent pour créer des garnisons locales dans chaque district, équipées et encadrées par des réservistes ou anciens militaires, afin d’enseigner aux civils l’usage d’armes légères (fusils d’assaut T-91, grenades) et des tactiques de combat élémentaires. Des exercices conjoints civils-militaires réguliers sont envisagés pour améliorer l’interopérabilité et la résilience de la société face à une guerre asymétrique.
L’armée taïwanaise organise fréquemment des exercices de « réponse immédiate » mobilisant toutes ses composantes pour s’entraîner à réagir rapidement aux incursions chinoises. Les pilotes de chasse, notamment sur la base de Hsinchu (aéroport de Taïwan situé près de la ville de Hsinchu dans le nord de l'île), sont notamment soumis à un rythme intense de décollages d’urgence pour intercepter les avions chinois qui s’approchent de la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise. Cette pression constante éprouve hommes et matériels, mais Taïwan s’efforce de maintenir une capacité opérationnelle élevée.
Taïwan bénéficie d’un soutien militaire américain important, notamment via le Taiwan Relations Act, qui oblige Washington à fournir à l’île les moyens de se défendre. Cependant, les États-Unis encouragent Taïwan à privilégier les armes asymétriques plutôt que les équipements lourds, estimant que ces derniers seraient rapidement neutralisés en cas d’attaque chinoise. Ce soutien se traduit par des ventes d’armes portables, de missiles et de drones, ainsi que par un partage d’expertise stratégique.
Pour rappel, le Taiwan Relations Act constitue une législation du Congrès américain adoptée en 1979 qui encadre les rapports entre les États-Unis et Taïwan, suite à la reconnaissance diplomatique de la Chine. Cette loi évite d'employer l'expression « République de Chine » et fait référence aux « autorités qui gouvernent Taïwan ». Elle annule l'ensemble des accords conclus entre les États-Unis et la République de Chine antérieurement à 1979, et établit des relations avec le gouvernement de Taipei identiques à celles entretenues avec tout autre pays, hormis l'absence de reconnaissance diplomatique officielle et de reconnaissance de la République de Chine. Elle permet notamment les ventes d'armements défensifs à Taïwan. Le Taiwan Relations Act n'offre aucune garantie d'intervention militaire américaine au profit de Taïwan en cas d'invasion chinoise. Washington maintient à ce sujet une ambiguïté stratégique visant à dissuader tant une déclaration unilatérale d'indépendance taïwanaise qu'une annexion forcée de Taïwan par la Chine.
Taïwan combine :
- La modernisation de ses forces conventionnelles (avions, navires, missiles)
- Le développement d’une défense asymétrique inspirée par l’expérience ukrainienne
- La formation progressive de ses civils à la défense armée
- Des exercices militaires réguliers pour maintenir la vigilance
- Un partenariat stratégique avec les États-Unis pour renforcer ses capacités
Cette approche vise à rendre toute tentative d’invasion chinoise trop coûteuse et risquée, tout en mobilisant la société dans son ensemble pour accroître la résilience nationale face à la menace croissante.
Les signaux d'alarme se multiplient aujourd’hui sur le front sino-taïwanais. Depuis 2020, la stratégie chinoise est marquée par une montée continue de la coercition militaire, politique et économique, ponctuée par des exercices de plus en plus ambitieux et des menaces explicites à chaque étape politique majeure à Taïwan. L’arrivée au pouvoir de Lai Ching-te en 2024 a marqué un tournant, Pékin considérant désormais la situation comme suffisamment grave pour justifier des démonstrations de force quasi permanentes. Le risque d’un affrontement direct n’a jamais été aussi élevé depuis des décennies…